L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
+12
aliochaverkiev
benfifi
Bergame
alain
kercoz
denis_h
jean tardieu
Jans
baptiste
hks
Crosswind
maraud
16 participants
DIGRESSION :: Philosophie :: Modernes :: Spinoza
Page 1 sur 35
Page 1 sur 35 • 1, 2, 3 ... 18 ... 35 
 L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Je propose de confronter, afin d’en débattre, l’Ethique de Spinoza à la spiritualité d’Ignace de Loyola.
Même si les deux approches sont nettement distinctes et ne peuvent être confondues, ce qui les rapproche, à mon avis, c’est que la philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie et que la méthode qu’Ignace de Loyola expose dans ses Exercices spirituels met en évidence que le christianisme est une religion de la joie.
Commençons, sur ce post, avec Spinoza.
L’ouvrage capital, l’Ethique, culmine dans sa partie V lorsque est explicitée la connaissance du troisième genre et ses conséquences.
Dans la partie II, Spinoza a distingué trois genres de connaissance (E II 40 sc. 2) :
- L’opinion ou imagination, connaissance inadéquate
- La connaissance du deuxième genre ou raison, connaissance adéquate
- La science intuitive, connaissance qui « procède de l’idée adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l’essence des choses ».
En clair, dans la science intuitive ou connaissance du troisième genre, nous connaissons les choses dans leur lien avec Dieu, c’est-à-dire que nous avons conscience que les choses sont des modes de la substance unique que Spinoza appelle Dieu.
On peut dire que cette connaissance est « religieuse », au sens où Spinoza a défini la religion :
En outre, Spinoza démontre que, du troisième genre de connaissance « naît la plus haute satisfaction de l’Esprit qu’il puisse y avoir » (E V 27) et « naît un amour intellectuel de Dieu » (E V 32 sc.)
Nous sommes donc dans une perspective nettement religieuse, au sens de Spinoza : nous connaissons que les choses dépendent de Dieu, d’un Dieu que nous aimons, ce qui nous procure la plus grande joie.
Ajoutons que Spinoza démontre plus loin que Dieu aime les hommes :
Il y aura lieu de confronter cette « religion » au christianisme, tel que l’envisage pratiquement Ignace de Loyola dans ses Exercices.
Même si les deux approches sont nettement distinctes et ne peuvent être confondues, ce qui les rapproche, à mon avis, c’est que la philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie et que la méthode qu’Ignace de Loyola expose dans ses Exercices spirituels met en évidence que le christianisme est une religion de la joie.
Commençons, sur ce post, avec Spinoza.
L’ouvrage capital, l’Ethique, culmine dans sa partie V lorsque est explicitée la connaissance du troisième genre et ses conséquences.
Dans la partie II, Spinoza a distingué trois genres de connaissance (E II 40 sc. 2) :
- L’opinion ou imagination, connaissance inadéquate
- La connaissance du deuxième genre ou raison, connaissance adéquate
- La science intuitive, connaissance qui « procède de l’idée adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l’essence des choses ».
En clair, dans la science intuitive ou connaissance du troisième genre, nous connaissons les choses dans leur lien avec Dieu, c’est-à-dire que nous avons conscience que les choses sont des modes de la substance unique que Spinoza appelle Dieu.
On peut dire que cette connaissance est « religieuse », au sens où Spinoza a défini la religion :
Spinoza (E IV 37 sc. 1) a écrit: Je rapporte à la Religion tous les désirs et toutes les actions dont nous sommes cause en tant que nous avons l’idée de Dieu, c’est-à-dire en tant que nous connaissons Dieu
En outre, Spinoza démontre que, du troisième genre de connaissance « naît la plus haute satisfaction de l’Esprit qu’il puisse y avoir » (E V 27) et « naît un amour intellectuel de Dieu » (E V 32 sc.)
Nous sommes donc dans une perspective nettement religieuse, au sens de Spinoza : nous connaissons que les choses dépendent de Dieu, d’un Dieu que nous aimons, ce qui nous procure la plus grande joie.
Ajoutons que Spinoza démontre plus loin que Dieu aime les hommes :
Spinoza (E V 36 cor. a écrit: De là suit que Dieu, en tant qu’il s’aime lui-même, aime les hommes, et par conséquent, que l’amour de Dieu envers les hommes et l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une seule et même chose
Il y aura lieu de confronter cette « religion » au christianisme, tel que l’envisage pratiquement Ignace de Loyola dans ses Exercices.
Dernière édition par Vanleers le Jeu 14 Nov 2019 - 21:48, édité 1 fois
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Avant d’en venir à Ignace de Loyola, je signale un article de Frédéric Manzini : « La valeur de joie chez Spinoza » qui précise ce qu’il faut entendre quant on dit que Spinoza est un philosophe de la joie. On peut le lire en :
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2014-2-page-237.htm
L’auteur commence ainsi son article :
Après avoir rappelé différents termes qu’utilise Spinoza à propos de la joie, l’auteur en vient à la béatitude :
F. Manzini s’applique ensuite à montrer que Spinoza utilise indifféremment les concepts de joie (laetitia) et béatitude (beatitudo) pour désigner la même réalité.
Il faut toutefois entendre que, dans ce cas, il s’agit de joie active et il écrit, commentant la démonstration d’E V 27 :
On dira donc, plus précisément, que Spinoza est un philosophe de la béatitude.
Nous terminerons la lecture de l’article de F. Manzini dans le prochain post qui ouvre à une discussion sur le rapport entre la philosophie de Spinoza et la religion chrétienne.
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2014-2-page-237.htm
L’auteur commence ainsi son article :
Frédéric Manzini a écrit:C’est un lieu commun de voir dans le spinozisme une philosophie du bonheur ou plus exactement de la joie. Non pas que la vie personnelle de Spinoza fut elle-même ni très joyeuse ni particulièrement heureuse – pour le peu que nous connaissons d’elle et pour autant qu’on puisse juger de l’extérieur ce genre de choses. Mais il est vrai qu’en philosophie sa doctrine se distingue par l’accent qu’elle met sur l’existence d’une joie inhérente à l’obtention de la vérité et de la sagesse, non seulement comme si la marche en avant dans son système s’accompagnait de joie, mais encore et surtout comme si la joie était nécessaire à ce progrès et en constituait un ressort absolument essentiel, en plus d’en constituer l’orientation finale.
Après avoir rappelé différents termes qu’utilise Spinoza à propos de la joie, l’auteur en vient à la béatitude :
Frédéric Manzini a écrit:La beatitudo, d’autre part, parce que c’est à elle que la totalité de l’Éthique se trouve suspendue, comme l’indique l’ultime proposition de l’ouvrage qui fait d’elle le but de tout le parcours qui a été proposé. C’est vers son expérience ultime que tout le projet est organisé, comme annoncé déjà dès la petite préface à la deuxième partie de l’Éthique, où Spinoza explique qu’il s’agit pour lui de conduire son lecteur quasi manu vers cette beatitudo.
F. Manzini s’applique ensuite à montrer que Spinoza utilise indifféremment les concepts de joie (laetitia) et béatitude (beatitudo) pour désigner la même réalité.
Il faut toutefois entendre que, dans ce cas, il s’agit de joie active et il écrit, commentant la démonstration d’E V 27 :
Frédéric Manzini a écrit:On remarque cependant que la joie dont il est ici question est qualifiée de « souveraine ». En effet, ce ne sont pas toutes les joies que l’on peut identifier à la béatitude. Celles-ci ne sont assurément pas les joies passives qui sont subies à partir des déterminations extérieures. Ce sont donc les joies telles qu’elles commencent à s’inscrire dans le processus éthique à la suite d’Éthique, III, 58 et qui prennent toute leur place dans la cinquième partie, autrement dit les joies actives, autrement dit celles qui reposent sur la compréhension de sa propre puissance d’agir à partir d’idées adéquates.
On dira donc, plus précisément, que Spinoza est un philosophe de la béatitude.
Nous terminerons la lecture de l’article de F. Manzini dans le prochain post qui ouvre à une discussion sur le rapport entre la philosophie de Spinoza et la religion chrétienne.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Frédéric Manzini s’emploie, à la fin de son article, à montrer que la béatitude, c’est-à-dire le but de l’Ethique, n’a pas nécessairement de caractère religieux :
L’auteur confirme ce point de vue dans la conclusion :
F. Manzini rappelle ainsi que la philosophie de Spinoza est une philosophie de l’immanence et que ce que Spinoza appelle Dieu n’est pas extérieur au monde mais qu’il en est la substance.
Nous allons maintenant aborder la spiritualité d’Ignace de Loyola.
Frédéric Manzini a écrit:Il [Spinoza] considère que la béatitude n’est finalement rien de fondamentalement différent par rapport à la joie que nous connaissons déjà mais qui se trouve portée à son plus haut degré d’accomplissement. Autrement dit, son audace ne consiste pas à soutenir que la prétendue béatitude est inaccessible au commun des mortels et que seule la joie existe, mais à montrer qu’elle n’a pas nécessairement de caractère religieux et que la raison y conduit de la façon la plus naturelle qui soit. Il y a des athées bienheureux comme il y a des athées vertueux : ce sont d’ailleurs les mêmes pour Spinoza, puisque la béatitude n’est pas la récompense de la vertu mais la vertu elle-même, pour reprendre les termes de la célèbre formule qui clôt l’Éthique – et dont on ne saurait trop rappeler le caractère éminemment polémique puisqu’elle contredit très littéralement l’opinion dominante, elle-même fondée sur l’interprétation d’Aristote par Thomas d’Aquin érigeant au contraire la beatitudo en praemium virtutis, comme si les préjugés du sens commun et les superstitions religieuses se rejoignaient dans la tristesse d’un égarement naïf.
L’auteur confirme ce point de vue dans la conclusion :
Frédéric Manzini a écrit:Le spinozisme est donc bien plus qu’une philosophie de la joie, car la joie spinozienne y vaut plus que pour elle-même et signifie davantage que ce sentiment qui accompagne et marque tout progrès intellectuel. Elle est une philosophie de la béatitude entendue en un sens ouvertement irréligieux qui la ramène au bonheur. Techniquement, la béatitude correspond au concept spinoziste de joie active, c’est-à-dire d’une joie qui ne vient pas des circonstances heureuses mais d’une joie dont le sujet qui l’éprouve se trouve être lui-même la cause – Dieu n’en étant la cause que comme la substance dont le sujet est le mode et non plus comme une entité extérieure. Il n’y a plus rien à espérer que cette joie souveraine, ou summa laetitia, autrement dit il n’y a rien à espérer de plus qu’elle, ce qui, loin de conduire à une quelconque désespérance, est supposé conforter cette joie même.
F. Manzini rappelle ainsi que la philosophie de Spinoza est une philosophie de l’immanence et que ce que Spinoza appelle Dieu n’est pas extérieur au monde mais qu’il en est la substance.
Nous allons maintenant aborder la spiritualité d’Ignace de Loyola.
Dernière édition par Vanleers le Lun 11 Nov 2019 - 21:17, édité 1 fois
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
(merci Vanleers. Mais je n'ai jamais lu Ignace ! Mais les connaissances relevant du " troisième genre " sont un de mes terrains de prédilection. On peut relever cet affreux paradoxe : que les religions, si proches du Dieu, le plus souvent, bloquent, figent, l'individu sur le chemin, et une théologie, ou connaissance du troisième genre, totalement libre de ses mouvements avec.)
_________________
" Tout Étant produit par moi m'est donné (c'est son statut philosophique), a priori, et il est Mien (cogito, conscience de Soi, libéré du Poêle) ". " Savoir guérit, forge. Et détruit tout ce qui doit l'être ", ou, équivalents, " Tout l'Inadvertancier constitutif doit disparaître ", " Le progrès, c'est la liquidation du Sujet empirique, notoirement névrotique, par la connaissance ". " Il faut régresser et recommencer, en conscience ". Moi.
C'est à pas de colombes que les Déesses s'avancent.

neopilina- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 8364
Date d'inscription : 31/10/2009
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
neopilina a écrit:(merci Vanleers. Mais je n'ai jamais lu Ignace ! Mais les connaissances relevant du " troisième genre " sont un de mes terrains de prédilection. On peut relever cet affreux paradoxe : que les religions, si proches du Dieu, le plus souvent, bloquent, figent, l'individu sur le chemin, et une théologie, ou connaissance du troisième genre, totalement libre de ses mouvements avec.)
Je suis d'accord.
Spinoza, déjà, était très critique vis-à-vis des chrétiens de son temps (cf. Le Traité Théologico-Politique)
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Ignace de Loyola (1491-1556) est un prêtre fondateur de l’ordre des Jésuites.
Il est l’auteur d’un livre encore célèbre aujourd’hui : les Exercices spirituels.
Il s’agit d’un livre de méditation et de prière élaboré à partir de sa propre expérience.
Il est sans doute difficile aujourd’hui de parler de christianisme tant les critiques des religions et des chrétiens en particulier se sont multipliées dans notre société, souvent à juste titre.
Je prends toutefois le risque d’introduire la spiritualité d’Ignace de Loyola par la citation d’un jésuite, en tête d’un petit ouvrage dédié à cette spiritualité (Vers le bonheur durable – Vie chrétienne 1993), en espérant capter la bienveillance du lecteur :
« Vivre de la Vie bienheureuse de Dieu » ! On peut rapprocher cette expression de ce qu’écrit Spinoza lorsqu’il dit que « la nature de Dieu jouit (ou se réjouit) de son infinie perfection » (démonstration d’E V 35 : Dieu s’aime lui-même d’un Amour intellectuel infini) et que « l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une partie de l’amour infini dont Dieu s’aime lui-même » (E V 36)
Poursuivons car l’auteur va être plus précis :
Il est surprenant, en tout cas j’ai été surpris, de lire que « Dieu veut le bonheur de l’homme ».
Lorsqu’on lit la Bible, on constate, en effet, que Dieu dont il est question veut le bonheur de l’homme.
Dans la spiritualité d’Ignace de Loyola, la joie est une boussole, ce qui est également le cas dans l’Ethique, comme le souligne Frédéric Manzini dans l’article que nous avons vu précédemment.
Cette spiritualité est foncièrement optimiste, je dirais presque, eudémoniste.
Il est l’auteur d’un livre encore célèbre aujourd’hui : les Exercices spirituels.
Il s’agit d’un livre de méditation et de prière élaboré à partir de sa propre expérience.
Il est sans doute difficile aujourd’hui de parler de christianisme tant les critiques des religions et des chrétiens en particulier se sont multipliées dans notre société, souvent à juste titre.
Je prends toutefois le risque d’introduire la spiritualité d’Ignace de Loyola par la citation d’un jésuite, en tête d’un petit ouvrage dédié à cette spiritualité (Vers le bonheur durable – Vie chrétienne 1993), en espérant capter la bienveillance du lecteur :
Adrien Demoustier a écrit:La vie chrétienne est une réponse à un appel, une invitation à vivre de la Vie bienheureuse de Dieu qui veut nous la communiquer par le Christ. Dieu appelle l’homme à exister par lui-même dans le dessein de pouvoir l’introduire dans sa propre intimité. Telle est notre foi et le témoignage de ceux qui nous précèdent sur le chemin de la réponse à cette invitation.
« Vivre de la Vie bienheureuse de Dieu » ! On peut rapprocher cette expression de ce qu’écrit Spinoza lorsqu’il dit que « la nature de Dieu jouit (ou se réjouit) de son infinie perfection » (démonstration d’E V 35 : Dieu s’aime lui-même d’un Amour intellectuel infini) et que « l’Amour intellectuel de l’Esprit envers Dieu est une partie de l’amour infini dont Dieu s’aime lui-même » (E V 36)
Poursuivons car l’auteur va être plus précis :
Adrien Demoustier a écrit:Le bonheur, sa recherche et son accueil sont la marque et le point de repère essentiel de tout discernement.
A la racine de cette affirmation, il y a le rappel d’une vérité fondamentale de notre foi chrétienne, souvent méconnue parce qu’elle prend à revers l’évidence immédiate. Son acceptation demande effectivement un acte de foi : croire que Dieu veut le bonheur de l’homme parce que telle est sa très sainte et libre volonté. Dans la continuelle présence de son éternité à notre temps, il a créé l’homme à l’origine et le crée sans cesse, chaque jour, pour lui offrir de recevoir, librement, la communication de sa Vie bienheureuse. Choisir de faire la volonté de Dieu sera toujours, d’une façon ou d’une autre, une détermination qui permettra de trouver paix et joie au travers de la difficulté de vivre. Bonheur ne veut pas dire facilité. Suivre le Christ donne d’expérimenter mystérieusement et dans la nuit, que nous commençons à sortir du malheur dans lequel nous nous enfermions nous-mêmes.
Il est surprenant, en tout cas j’ai été surpris, de lire que « Dieu veut le bonheur de l’homme ».
Lorsqu’on lit la Bible, on constate, en effet, que Dieu dont il est question veut le bonheur de l’homme.
Dans la spiritualité d’Ignace de Loyola, la joie est une boussole, ce qui est également le cas dans l’Ethique, comme le souligne Frédéric Manzini dans l’article que nous avons vu précédemment.
Cette spiritualité est foncièrement optimiste, je dirais presque, eudémoniste.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Je crois que dire de Dieu qu'il s'aime lui-même, relève de l'esprit de système car on entend par là que Dieu est comme un système, un rouage qui fonctionne pour lui-même... Cela n'est pas totalement absurde, mais il faudrait dans ce cas ajouter qu'il faut s'aimer soi-même pour "goûter" à l'Amour de Dieu. Dans un autre genre, on dit aussi: " Dieu n'aime que lui-même" pour dire que ce n'est pas à Dieu de venir à nous mais à nous d'aller à Dieu.
S'aimer soi-même doit être compris comme aimer participer de ce Tout Parfait et non comme jouisseur de son individualité. La Religion éloigne de l'individualité et c'est en cela qu'elle est déjà une étape franchie vers Dieu. Pour autant cela ne présume de rien car le fait d'avoir la foi est un paradoxe que peu parviennent à surmonter.
Je ne voudrais pas m'étaler, mais il faut tout de même noter que Spinoza porte un culte à l'esprit qui parvient à la connaissance du troisième genre et je crois que cette forme de culte est indispensable si l'on veut quelque peu déborder le paradoxe de la foi qui s'exprime au travers du sentiment, fût-il bon.
_________________
La vie est belle!
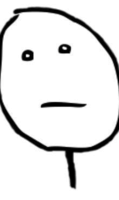
maraud- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2464
Date d'inscription : 04/11/2012
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
A maraud
Je trouve vos critiques justifiées et intéressantes.
1) Vous écrivez que le Dieu de Spinoza « est comme un système, un rouage qui fonctionne pour lui-même ».
C’est bien vu et on est ici très loin du Dieu créateur et personnel de la Bible.
Je pense aussi que vous avez raison lorsque vous en déduisez que, dans ce cas, il faut s’aimer soi-même pour goûter à l’Amour de Dieu.
2) Vous rapportez que l’on dit parfois que « Dieu n'aime que lui-même ».
Les chrétiens, qui soutiennent que « Dieu est amour » (Saint Jean) et même que « Dieu n’est qu’amour » (Varillon), défendent l’idée d’un Dieu trinitaire afin de sortir de cette affirmation restrictive.
3) Vous écrivez que « S'aimer soi-même doit être compris comme aimer participer de ce Tout Parfait »
Je pense que c’est vrai chez Spinoza, sans que cette participation soit une fusion dans le Tout parfait.
En milieu chrétien, cette participation me paraît pouvoir se traduire par « Vivre de la Vie bienheureuse de Dieu », comme l’écrit A. Demoustier que j’ai cité dans mon post précédent.
4) Vous écrivez que « La Religion éloigne de l'individualité ».
Vous rejoignez ici la thèse de Maurice Zundel , souvent considéré comme un mystique chrétien personnaliste, qui soutient que l’« individu », fermé sur lui-même, doit céder la place à la « personne », ouverte aux autres, la personnalisation de l’homme étant effectuée par Dieu.
5) Vous écrivez que « Spinoza porte un culte à l'esprit qui parvient à la connaissance du troisième genre ».
Cette connaissance, d’où naît la béatitude, but de l’Ethique, est en effet le sommet de la voie spinozienne mais il faut noter que cette connaissance est à la fois intellectuelle et affective, ce qui la rapproche de la démarche ignatienne comme j’essaierai de le montrer plus tard.
Je trouve vos critiques justifiées et intéressantes.
1) Vous écrivez que le Dieu de Spinoza « est comme un système, un rouage qui fonctionne pour lui-même ».
C’est bien vu et on est ici très loin du Dieu créateur et personnel de la Bible.
Je pense aussi que vous avez raison lorsque vous en déduisez que, dans ce cas, il faut s’aimer soi-même pour goûter à l’Amour de Dieu.
2) Vous rapportez que l’on dit parfois que « Dieu n'aime que lui-même ».
Les chrétiens, qui soutiennent que « Dieu est amour » (Saint Jean) et même que « Dieu n’est qu’amour » (Varillon), défendent l’idée d’un Dieu trinitaire afin de sortir de cette affirmation restrictive.
3) Vous écrivez que « S'aimer soi-même doit être compris comme aimer participer de ce Tout Parfait »
Je pense que c’est vrai chez Spinoza, sans que cette participation soit une fusion dans le Tout parfait.
En milieu chrétien, cette participation me paraît pouvoir se traduire par « Vivre de la Vie bienheureuse de Dieu », comme l’écrit A. Demoustier que j’ai cité dans mon post précédent.
4) Vous écrivez que « La Religion éloigne de l'individualité ».
Vous rejoignez ici la thèse de Maurice Zundel , souvent considéré comme un mystique chrétien personnaliste, qui soutient que l’« individu », fermé sur lui-même, doit céder la place à la « personne », ouverte aux autres, la personnalisation de l’homme étant effectuée par Dieu.
5) Vous écrivez que « Spinoza porte un culte à l'esprit qui parvient à la connaissance du troisième genre ».
Cette connaissance, d’où naît la béatitude, but de l’Ethique, est en effet le sommet de la voie spinozienne mais il faut noter que cette connaissance est à la fois intellectuelle et affective, ce qui la rapproche de la démarche ignatienne comme j’essaierai de le montrer plus tard.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
A Bergame ou hks
J'ai fait une erreur dans le titre du sujet que je n'arrive pas à corriger.
Il s'agit de "L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne"
Pouvez-vous faire la correction ?
Merci
J'ai fait une erreur dans le titre du sujet que je n'arrive pas à corriger.
Il s'agit de "L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne"
Pouvez-vous faire la correction ?
Merci
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Vanleers a écrit:Les chrétiens, qui soutiennent que « Dieu est amour » (Saint Jean) et même que « Dieu n’est qu’amour » (Varillon), défendent l’idée d’un Dieu trinitaire afin de sortir de cette affirmation restrictive.
Et ils ont raison. Ils ont raison car si l'on est logique et que l'on veut être conséquent, il faut bien admettre que si le Commun ne peut aller à Dieu par ses propres moyens, il faut alors l'en rapprocher par d'autres moyens...La voie directe passe par l'esprit/intellect, or si ce Commun des mortels n'a pas la capacité intellectuelle d'emprunter cette voie " royale", il est alors conséquent d'utiliser la pratique religieuse comme une "prothèse intellectuelle" pour l'y amener.....peu ou proue. Et dans ce cas, la Religion n'est pas un " en soi" mais un moyen. C'est un moyen qui vise à contrer la barbarie de l'individualisme et par extension la barbarie du fractionnement de l'humanité en entités sentimentalement déterminées. Je crois, moi aussi, que la Religion n'est pas apparue comme un plus, mais plus trivialement comme un moyen d'endiguer une altération de l'esprit humain. En tout cas c'est ainsi que je conçois la distinction entre l'ésotérisme qui est un en soi et l'exotérisme qui est "utilitaire", d'autant que toutes les religions semblent toujours s'adosser à des doctrines ésotériques ( distinction du sacré et du profane, dont nombre d'improbables modernes font état sans trop y comprendre grand chose...)
Je crois que l'époque actuelle justifie grandement ce que je viens de dire et à quoi j'ajouterais que la Religion, quand elle prétend se suffire à elle-même n'est rien d'autre qu'un simulacre de connaissance qui, pollué par le sentimentalisme, ne peut jamais élever qui que ce soit vers Dieu ( c'est là le paradoxe que j'aperçois).
Vanleers a écrit:5) Vous écrivez que « Spinoza porte un culte à l'esprit qui parvient à la connaissance du troisième genre ».
Je pense que Spinoza présume un peu trop généreusement des capacités intellectuelles du Commun. Et je me dis qu'il commet l'erreur de croire que revenir à l'intellect ( après le détours par la religion) parce que celui-ci est en ligne plus direct vers Dieu est un jugement moral qui inverse l'ordre de la cause et de l'effet: le jugement moral ( mieux, préférable...) ne doit pas s'appliquer à l'intellect qui doit être d'une autonomie absolue si l'on veut le dégager du sentiment. Ainsi, je pense que l'oeuvre de Spinoza aurait dû être toute ésotérique ou toute exotérique et que le "mix " qu'il propose manque fâcheusement sa cible puisque ni les esprits libres ni le Commun ne peuvent l'accepter dans son entièreté.
Pour image, c'est comme si Spinoza nous avait généreusement convié à sa table, et voulant contenter tout le monde, il nous aurait concocté un plat où se mélangeraient des ingrédients qui, tous gouteux, à la fin seraient malgré tout incomestibles...
Je crois qu'il n'y a pas place pour le " démocratisme" dans l'intellectualité, à fortiori pure.
_________________
La vie est belle!
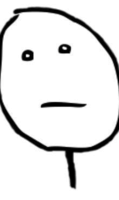
maraud- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2464
Date d'inscription : 04/11/2012
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
A maraud
Avant de poursuivre l’exposé de la spiritualité ignatienne, je vais essayer de répondre à vos remarques.
1) Vous distinguez une voie directe, « royale », celle de l’esprit/intellect qui n’est pas accessible au commun des mortels et la pratique religieuse, conçue comme une « prothèse intellectuelle ».
On retrouve la même idée chez Victor Brochard (Le Dieu de Spinoza – Manucius 2013)
On peut lire le texte en :
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Dieu_de_Spinoza
L’auteur renforce cette thèse :
2) Vous soutenez que « l'intellect [...] doit être d'une autonomie absolue si l'on veut le dégager du sentiment ».
Mais, comme je l’ai déjà rappelé, l’intellect n’est pas dégagé de l’affectivité dans la connaissance du troisième genre. Précisons qu’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une affectivité passionnelle mais active.
Pour vous rejoindre, je dirais que l’intellect est alors dégagé de ce que vous appelez le « sentimentalisme ».
Avant de poursuivre l’exposé de la spiritualité ignatienne, je vais essayer de répondre à vos remarques.
1) Vous distinguez une voie directe, « royale », celle de l’esprit/intellect qui n’est pas accessible au commun des mortels et la pratique religieuse, conçue comme une « prothèse intellectuelle ».
On retrouve la même idée chez Victor Brochard (Le Dieu de Spinoza – Manucius 2013)
On peut lire le texte en :
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Dieu_de_Spinoza
Victor Brochard a écrit:[…] il y a équivalence entre la doctrine qui déduit la vertu des vérités nécessaires et l’assertion que la même vertu est prescrite par un décret divin. C’est au fond la même chose présentée sous deux formes distinctes, l’une adéquate, l’autre inadéquate. (p. 35)
L’auteur renforce cette thèse :
Victor Brochard a écrit:Ce qui importe avant tout selon lui [Spinoza], et ce qu’il met au-dessus de la science aussi bien que de la morale, ce sont la justice, la charité et l’amour de Dieu. La connaissance rationnelle et la foi ne sont en dernière analyse que des moyens en vue de cette fin. S’il écrit l’Éthique, c’est pour prouver que la raison, à l’aide de la lumière naturelle, conduit à la vertu et à l’amour de Dieu. S’il écrit la première partie du Traité théologico-politique, c’est pour montrer que la foi a pour objet essentiel la vertu et la piété. (p. 57)
2) Vous soutenez que « l'intellect [...] doit être d'une autonomie absolue si l'on veut le dégager du sentiment ».
Mais, comme je l’ai déjà rappelé, l’intellect n’est pas dégagé de l’affectivité dans la connaissance du troisième genre. Précisons qu’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une affectivité passionnelle mais active.
Pour vous rejoindre, je dirais que l’intellect est alors dégagé de ce que vous appelez le « sentimentalisme ».
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
(Petite incise avant de vous laisser terminer votre exposé)
Je nuancerais cependant mon propos en ne fustigeant pas ceux qui, constitués autrement, sont comblés par leur amour sentimental de Dieu sans avoir recours à l'intellect dans sa composante de logique froide. Je ne sais rien de cet état et tout ce qui m'est donné ne peut prétendre se substituer à un autre point de vue. Il arrive qu'il y ait quelque chose de très profond dans le sentiment et je redoute que cette profondeur ne rejoigne adéquatement la froide logique par je ne sais quelle voie; cela m'impose de ne pas considérer mon point de vue avec certitude.
Je crois pouvoir avancer que c'est une question de qualité: il y a des qualités de sentiments qui dépassent la nécessité de la logique; je les suppose chez les saints ou les prophètes mais je n'en ai aucune expérience...
Je nuancerais cependant mon propos en ne fustigeant pas ceux qui, constitués autrement, sont comblés par leur amour sentimental de Dieu sans avoir recours à l'intellect dans sa composante de logique froide. Je ne sais rien de cet état et tout ce qui m'est donné ne peut prétendre se substituer à un autre point de vue. Il arrive qu'il y ait quelque chose de très profond dans le sentiment et je redoute que cette profondeur ne rejoigne adéquatement la froide logique par je ne sais quelle voie; cela m'impose de ne pas considérer mon point de vue avec certitude.
Je crois pouvoir avancer que c'est une question de qualité: il y a des qualités de sentiments qui dépassent la nécessité de la logique; je les suppose chez les saints ou les prophètes mais je n'en ai aucune expérience...
_________________
La vie est belle!
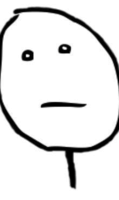
maraud- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2464
Date d'inscription : 04/11/2012
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
La philosophie de Spinoza est une philosophie de la joie et même, comme nous l’avons vu avec Frédéric Manzini, une philosophie de la béatitude.
Spinoza précise que « la béatitude consiste dans l’Amour envers Dieu qui naît de la connaissance du troisième genre » (E V 42 dém.)
Je dirais maintenant que la spiritualité ignatienne est une spiritualité de la joie.
En effet, la notion centrale de cette spiritualité est la consolation spirituelle, qui n’est autre que la joie donnée par Dieu.
Dans ses Exercices Spirituels (§ 329) :
Le chrétien est ainsi invité à discerner par quel esprit il est mû.
Est-ce par l’esprit de Dieu, l’Esprit Saint qui donne la joie (la consolation spirituelle) et va toujours dans le sens de la vie ?
Ou est-ce par le mauvais esprit qui va toujours dans le sens de la mort et apporte la désolation spirituelle ?
Ignace précise ce qu’il entend par consolation et désolation spirituelles :
Si le discernement des esprits est toujours nécessaire, il l’est en particulier au moment de prendre une décision, surtout si celle-ci est importante.
Ignace invite alors le chrétien à se mettre en présence de Dieu dans la prière et à être attentif à ce qu’il ressent en profondeur.
Si la motion affective éprouvée relève de la consolation spirituelle, c’est que la décision est bonne.
Spinoza précise que « la béatitude consiste dans l’Amour envers Dieu qui naît de la connaissance du troisième genre » (E V 42 dém.)
Je dirais maintenant que la spiritualité ignatienne est une spiritualité de la joie.
En effet, la notion centrale de cette spiritualité est la consolation spirituelle, qui n’est autre que la joie donnée par Dieu.
Dans ses Exercices Spirituels (§ 329) :
Ignace de Loyola a écrit:C’est le propre de Dieu et de ses anges de donner, dans leurs motions, la véritable allégresse et joie spirituelle, en supprimant toute tristesse et trouble que suscite l’ennemi. Le propre de celui-ci est de lutter contre cette allégresse et cette consolation spirituelle, en présentant des raisons apparentes, des subtilités et de continuels sophismes.
Le chrétien est ainsi invité à discerner par quel esprit il est mû.
Est-ce par l’esprit de Dieu, l’Esprit Saint qui donne la joie (la consolation spirituelle) et va toujours dans le sens de la vie ?
Ou est-ce par le mauvais esprit qui va toujours dans le sens de la mort et apporte la désolation spirituelle ?
Ignace précise ce qu’il entend par consolation et désolation spirituelles :
Ignace de Loyola a écrit:Troisième règle [...] En définitive, j’appelle consolation tout accroissement d’espérance, de foi et de charité, et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l’âme, l’apaisant et la pacifiant en son Créateur et Seigneur(§ 316)
Quatrième règle […] J’appelle désolation tout le contraire de la troisième règle, comme par exemple, obscurité de l’âme, trouble intérieur, motion vers les choses basses et terrestres, absence de paix venant de diverses agitations et tentations qui poussent à un manque de confiance ; sans espérance, sans amour, l’âme se trouvant toute paresseuse, tiède, triste et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car de même que la consolation est à l’opposé de la désolation, de même les pensées qui proviennent de la consolation sont à l’opposé des pensées qui proviennent de la désolation (§ 317)
Si le discernement des esprits est toujours nécessaire, il l’est en particulier au moment de prendre une décision, surtout si celle-ci est importante.
Ignace invite alors le chrétien à se mettre en présence de Dieu dans la prière et à être attentif à ce qu’il ressent en profondeur.
Si la motion affective éprouvée relève de la consolation spirituelle, c’est que la décision est bonne.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
A maraud
Vous écrivez que :
« Il arrive qu'il y ait quelque chose de très profond dans le sentiment et je redoute que cette profondeur ne rejoigne adéquatement la froide logique »
Or, précisément, à la fin du scolie d’Ethique V 36, Spinoza écrit :
Considérer l’essence d’une chose singulière dans sa dépendance, c’est la connaître selon le troisième genre de connaissance, selon la définition de cette connaissance en E II 40 sc. 2 : qui « procède de l’idée adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l’essence des choses »
Or Spinoza démontre en E V 27 :
Selon Spinoza, la connaissance « de la froide logique » peut s’accompagner adéquatement de « quelque chose de très profond dans le sentiment ».
Vous écrivez que :
« Il arrive qu'il y ait quelque chose de très profond dans le sentiment et je redoute que cette profondeur ne rejoigne adéquatement la froide logique »
Or, précisément, à la fin du scolie d’Ethique V 36, Spinoza écrit :
Spinoza a écrit: Car, quoique j’aie montré de manière générale dans la Première Partie que tout (et par conséquent l’Esprit humain aussi) dépend de Dieu selon l’essence et selon l’existence, pourtant cette démonstration, quoiqu’elle soit légitime et sans risque de doute, n’affecte pourtant pas autant notre Esprit que lorsqu’on tire cette conclusion de l’essence même d’une chose singulière quelconque que nous disons dépendre de Dieu.
Considérer l’essence d’une chose singulière dans sa dépendance, c’est la connaître selon le troisième genre de connaissance, selon la définition de cette connaissance en E II 40 sc. 2 : qui « procède de l’idée adéquate de l’essence formelle de certains attributs de Dieu vers la connaissance adéquate de l’essence des choses »
Or Spinoza démontre en E V 27 :
Spinoza a écrit:De ce troisième genre de connaissance naît la plus haute satisfaction de l’Esprit qui puisse être donnée
Selon Spinoza, la connaissance « de la froide logique » peut s’accompagner adéquatement de « quelque chose de très profond dans le sentiment ».
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Vanleers a écrit: et que ce que Spinoza appelle Dieu n’est pas extérieur au monde mais qu’il en est la substance.
C'est donc une tautologie, présenté comme tel : il y a, et je peux danser sur ma tête, toutes les fois où je le constate, ce sera vrai.
Par contre, l'idée de substance cause d'elle-même ne me sera d'aucun secours dans ma folie, mon coma.
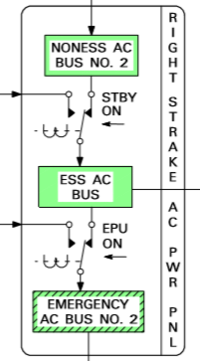
Crosswind- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2711
Date d'inscription : 29/07/2014
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Crosswind a écrit:Vanleers a écrit: et que ce que Spinoza appelle Dieu n’est pas extérieur au monde mais qu’il en est la substance.
C'est donc une tautologie, présenté comme tel : il y a, et je peux danser sur ma tête, toutes les fois où je le constate, ce sera vrai.
Par contre, l'idée de substance cause d'elle-même ne me sera d'aucun secours dans ma folie, mon coma.
Ce n'est pas une tautologie mais une définition : "Par Dieu, j'entends... " (Per Deum intelligo...) (Ethique I déf. 6)
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Vanleers a écrit:Crosswind a écrit:Vanleers a écrit: et que ce que Spinoza appelle Dieu n’est pas extérieur au monde mais qu’il en est la substance.
C'est donc une tautologie, présenté comme tel : il y a, et je peux danser sur ma tête, toutes les fois où je le constate, ce sera vrai.
Par contre, l'idée de substance cause d'elle-même ne me sera d'aucun secours dans ma folie, mon coma.
Ce n'est pas une tautologie mais une définition : "Par Dieu, j'entends... " (Per Deum intelligo...) (Ethique I déf. 6)
Dieu, par cette définition, est une substance. Or, qu'est-ce qu'une substance si ce n'est une chose (cause d'elle-même?). Il le dit lui-même, Dieu est une chose.
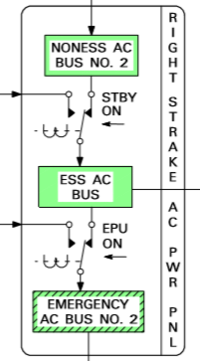
Crosswind- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2711
Date d'inscription : 29/07/2014
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Crosswind a écrit:
Dieu, par cette définition, est une substance. Or, qu'est-ce qu'une substance si ce n'est une chose (cause d'elle-même?). Il le dit lui-même, Dieu est une chose.
Oui, Dieu est une chose.
Spinoza définit Dieu comme une substance et non comme la substance.
Ceci est confirmé dans la définition elle-même qui est double : Dieu est un étant (on peut sous-entendre : parmi d’autres), une substance (et on peut sous-entendre aussi : parmi d’autres).
Ce n’est que dans la proposition 7 qu’est démontré qu’une substance est cause de soi et dans la proposition 14 que « A part Dieu, il ne peut y avoir ni se concevoir de substance ».
A Crosswind
Pour revenir au sujet, nos échanges mettent en évidence que le Dieu de Spinoza est différent du Dieu de la Bible sur lequel se fonde la spiritualité ignatienne.
Les remarques que vous faites, pour intéressantes qu’elles soient, devraient être débattues sur un autre topic.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Mais si Dieu est de cette sorte de "chose" qui, à tout bien considérer, englobe toute chose y compris elle-même, pourquoi donc un si long texte? Parce que, dans ce cas, la moindre de mes pensées n'est que Dieu incarné, le plus petit interstice de mon monde Lui appartient, et le problème est réglé en un quart de tour : "je" suis Dieu me pensant imparfait puis parfait, puis, puis…
Aucune ligne cohérente ne peut être défendue, puisque je suis Dieu.
A moins de défendre un Dieu pas si immanent que cela.
Mais pour comprendre le Dieu de Spinoza, il faut comprendre Spinoza !!! A quoi sert-il de comparer le Dieu de l'un avec l'autre lorsque l'idée que nous nous en faisons est imprécise?
Aucune ligne cohérente ne peut être défendue, puisque je suis Dieu.
A moins de défendre un Dieu pas si immanent que cela.
Vanleers a écrit:
Pour revenir au sujet, nos échanges mettent en évidence que le Dieu de Spinoza est différent du Dieu de la Bible sur lequel se fonde la spiritualité ignatienne.
Les remarques que vous faites, pour intéressantes qu’elles soient, devraient être débattues sur un autre topic.
Mais pour comprendre le Dieu de Spinoza, il faut comprendre Spinoza !!! A quoi sert-il de comparer le Dieu de l'un avec l'autre lorsque l'idée que nous nous en faisons est imprécise?
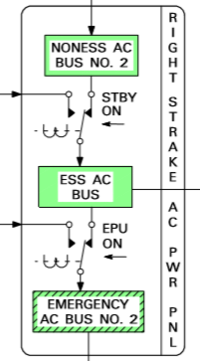
Crosswind- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2711
Date d'inscription : 29/07/2014
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Comme nous l’avons vu, la spiritualité ignatienne est une spiritualité de la joie.
Elle se fonde sur la religion chrétienne et témoigne que celle-ci est une religion de la joie.
C’est ce que dit le pape François, jésuite lui aussi, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium qu’on peut lire, par exemple, en :
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2514-B/La-joie-de-l-Evangile-2013-12-13-1066783
J’en cite le début :
Cela surprendra peut-être certains lecteurs, tant le christianisme reste méconnu aujourd’hui.
PS
A Crosswind
Je vous ai répondu sur le topic « Ontologie ».
Elle se fonde sur la religion chrétienne et témoigne que celle-ci est une religion de la joie.
C’est ce que dit le pape François, jésuite lui aussi, dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium qu’on peut lire, par exemple, en :
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Archives/Documentation-catholique-n-2514-B/La-joie-de-l-Evangile-2013-12-13-1066783
J’en cite le début :
le pape François a écrit:La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement.
Cela surprendra peut-être certains lecteurs, tant le christianisme reste méconnu aujourd’hui.
PS
A Crosswind
Je vous ai répondu sur le topic « Ontologie ».
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Que ces deux personnages visaient la béatitude -- une notion complexe ma foi -- peut parfaitement se comprendre. Je dirais même plus, qui ne la souhaite pas (même le plus vil sorcier, le plus méchant des méchant souhaite son propre bonheur)? L'un comme l'autre invoquent une rassurante présence de la substance : pour l'un l'immanence est pratiquement parfaite, pour l'autre la transcendance est pratiquement parfaite. Notez bien que, dans les deux cas, ni l'un ni l'autre ne sont parfaits.
Finalement, le problème réside peut-être dans la nébulosité des concepts employés. Tout le monde a peur de quelque chose, tout le monde peut mourir de tristesse. Mais peu, extrêmement peu, peuvent s'assurer de passer à travers les épreuves vécues ou attendues à la simple lecture de Spinoza ou de la Bible : au moment de mourir, nous sommes seuls, terriblement seuls, Absolument seul.
Ce qui n'empêche nullement les substances diverses et variées d'exister métaphysiquement, notez.
Finalement, le problème réside peut-être dans la nébulosité des concepts employés. Tout le monde a peur de quelque chose, tout le monde peut mourir de tristesse. Mais peu, extrêmement peu, peuvent s'assurer de passer à travers les épreuves vécues ou attendues à la simple lecture de Spinoza ou de la Bible : au moment de mourir, nous sommes seuls, terriblement seuls, Absolument seul.
Ce qui n'empêche nullement les substances diverses et variées d'exister métaphysiquement, notez.
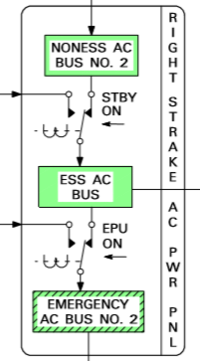
Crosswind- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 2711
Date d'inscription : 29/07/2014
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Crosswind a écrit:Mais peu, extrêmement peu, peuvent s'assurer de passer à travers les épreuves vécues ou attendues à la simple lecture de Spinoza ou de la Bible : au moment de mourir, nous sommes seuls, terriblement seuls, Absolument seuls.
Je suis bien d’accord : la simple lecture de Spinoza ou de la Bible ne donne pas l’assurance de passer à travers les épreuves vécues ou attendues.
Il faut davantage. Il faut que le lecteur soit touché en son affectivité profonde, en son cœur, et n’en reste pas à la simple compréhension intellectuelle de ce qu’il lit.
Cela est évident pour le chrétien mais me paraît vrai également pour le spinoziste qui doit mettre en pratique la théorie pour que celle-ci soit concrètement efficace au moment des épreuves.
Le chrétien n’est jamais seul car il fait confiance (a la foi en) à Dieu Amour qui est toujours avec lui, qui l’aime d’un amour inconditionnel et constant, même s’il ne ressent pas toujours cet amour.
Ici aussi, cela me paraît vrai pour le spinoziste qui a compris qu’il est un mode de Dieu Substance et, de ce fait, constamment car ontologiquement relié aux autres modes, même dans les épreuves
Il a également compris que « Dieu aime les hommes » (E V 36 cor.) mais, ici, je crains que cette connaissance reste le plus souvent froide et abstraite, donc inefficace dans les épreuves, alors que, par contraste, l’amour du Dieu de la Bible est foncièrement concret et chaud.
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
http://ethicadb.org/pars.php?parid=1&lanid=0&lg=frPer Deum intelligo ens absolute infinitum hoc est substantiam constantem infinitis attributis quorum unumquodque aeternam et infinitam essentiam exprimit.
Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. (Pautrat - fr)
Par Dieu j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs, chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie. (Misrahi - fr)
Vous, Vanleers, parlez de démonstrations qui interviennent ensuite.
Mais pour moi (quelle que soit la traduction de ce ens ( étant ou être) )
la nécessaire existence de Dieu comme exprimée par la seule définition s'impose
et ce parce que je ne peux ne pas en avoir l'idée.
Autrement dit pour moi il ne peut pas ne pas exister l'infinité, c'est à dire la causa sui .
Ce que j'ai dit à Crosswind sur le fil ontologie.
Je suis si l'on veut un partisan de Bradley.Francis Herbert Bradley.
"Apparences et réalité" n'a pas été traduit en Français.Bradley a écrit:If you identify the absolute with God that is not the God of religion"
Et donc à l’intérieur de la définition de Spinoza (celle de Dieu) les attributs, ce qui est une partition peut poser problème.
L'idée d attribut vient de notre supposé accès à deux attributs et c'est le commencement de la partition.
Mais cet accès duel est discutable.
Est discutable le fait que deux attributs soient autre qu'un effet de notre intellection.
hks- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 12510
Localisation : Hauts de Seine
Date d'inscription : 04/10/2007
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
hks a écrit:
Je suis si l'on veut un partisan de Bradley.Francis Herbert Bradley."Apparences et réalité" n'a pas été traduit en Français.Bradley a écrit:If you identify the absolute with God that is not the God of religion"
Pourquoi, diable, Spinoza a-t-il appelé « Dieu » ce qui fait l’objet de la définition 6 de la partie I de l’Ethique ?
Bradley n’est pas le premier à se poser la question mais ce qui m’intéresse, dans ce fil, c’est ce qu’en déduit pratiquement le spinoziste versus le comportement de l’adepte du Dieu de la Bible.
Plus précisément, j’ai pris conscience que le spinozisme culmine, dans la partie V de l’Ethique, dans une spiritualité, au sens où, dans la connaissance du troisième genre, toute chose est vue dans son lien avec Dieu.
Comme l’écrit Victor Brochard. (Le Dieu de Spinoza) : « On peut regretter que Spinoza ne se soit pas expliqué plus complètement sur cette vie en Dieu, par où s’achève toute sa doctrine. ».
J’ai donc été amené à m’intéresser à d’autres spiritualités susceptibles d’alimenter la vie en Dieu selon Spinoza et il m’est apparu que la spiritualité ignatienne, que je connaissais déjà mais superficiellement, était susceptible de remplir ce rôle.
Il est clair que le Dieu Substance de Spinoza n’est pas le Dieu Amour des chrétiens mais, au plan pratique, Ignace de Loyola a peut-être des choses intéressantes à dire au spinoziste et réciproquement.
En tout cas, c’est dans cette perspective que j’ai ouvert ce fil.
PS
Pourriez vous corriger le titre du fil, ce que je n’arrive pas à faire.
Il s’agit de « L’Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne ».
Merci
Vanleers- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 4214
Date d'inscription : 15/01/2017
 Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
Re: L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
détail technique: il me semble qu'en éditant votre premier message, vous puissiez réécrire le titre du fil. Mais je l'ai fait.
hks- Digressi(f/ve)

- Nombre de messages : 12510
Localisation : Hauts de Seine
Date d'inscription : 04/10/2007
Page 1 sur 35 • 1, 2, 3 ... 18 ... 35 
 Sujets similaires
Sujets similaires» L'Ethique de Spinoza et la spiritualité ignatienne
» Spinoza pas à pas : les DEFINITIONS (2)
» Éthique de Spinoza
» SPINOZA
» Spinoza pas à pas : les DEFINITIONS (4)
» Spinoza pas à pas : les DEFINITIONS (2)
» Éthique de Spinoza
» SPINOZA
» Spinoza pas à pas : les DEFINITIONS (4)
DIGRESSION :: Philosophie :: Modernes :: Spinoza
Page 1 sur 35
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

 par Vanleers Lun 11 Nov 2019 - 10:15
par Vanleers Lun 11 Nov 2019 - 10:15